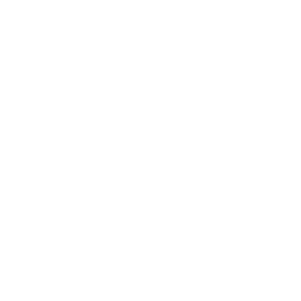Les sociétés face aux bouleversements climatiques. Penser ces changements en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cahier du GREC-SUD)
Résumé
/ Introduction /
L’origine anthropique des bouleversements climatiques actuels est sans conteste. L’intrication entre le climat et les choix collectifs portés par les institutions et les sociétés humaines est soulignée dans la synthèse du 6e rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) : en fonction des trajectoires socio-économiques qui seront prises au cours des prochaines décennies, le globe se réchauffera de 1,5°C à 5°C à l’horizon 2100. Ces trajectoires dépendent des choix de société des années à venir.
Les sciences humaines et sociales (science politique, histoire, sociologie, anthropologie, psychologie sociale, géographie, droit, économie…) sont donc cruciales pour guider l’action collective afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter nos territoires aux effets du changement climatique. Ces disciplines nous permettent également de mieux comprendre notre présent et de penser nos futurs, d’éclairer les transformations sociales impactées par les changements climatiques et environnementaux (transformation de nos métiers, de nos paysages du quotidien) et, plus largement, de repenser nos modèles économiques, politiques ou encore juridiques.
Un premier apport des sciences humaines et sociales est de fournir un recul historique face à des phénomènes nouveaux ou d’ampleur inédite. Ces recherches témoignent de la manière dont des sociétés antérieures aux nôtres ont agi face à des changements de climat, parfois très impactant bien que moins abrupts que ceux que nous connaissons aujourd’hui. Les fluctuations du petit âge glaciaire en Provence ont contraint les habitants à s’adapter à d’importantes inondations, à des froids exceptionnels ainsi qu’à des sécheresses longues et intenses. Déjà, les grandes stratégies nationales déclinées indépendamment des contextes locaux ont mis en évidence les contradictions entre développement agricole et déforestation, exposant les territoires de la Provence à des inondations inédites. Si le défi n’est pas nouveau, les témoignages de mal-adaptation de sociétés dans le passé doivent être relus à l’aune de l’accélération inédite de ces phénomènes climatiques extrêmes à l’heure actuelle.
Si le changement climatique constitue aujourd’hui une évidence scientifique, il n’a pas toujours fait l’objet du même traitement politique et médiatique : il a dû intégrer le débat public, conquérir les sphères décisionnaires aux échelles internationales et nationales. De nombreuses questions sont apparues : est-ce un phénomène cyclique, anthropique, inéluctable ? Afin de dépasser les perceptions et l’expérience immédiate, la variabilité saisonnière et spatiale, promouvoir des savoirs climatiques sur plusieurs décennies, la création, en 1988, du GIEC, a été cruciale pour établir ces évidences partagées, construire un savoir collectif clair et accepté. Malgré ce portage institutionnel et scientifique, les représentations du changement climatique continuent de fluctuer au fil des années, des évènements politiques, des extrêmes météorologiques. Les phénomènes que les sciences du climat et de l’environnement décrivent et quantifient depuis des décennies, sont différemment reçus et interprétés selon l’époque, le territoire ou bien la catégorie socio-professionnelle des individus. Lors de fortes canicules, ou après la tenue d’une COP, une attention toute particulière sera portée au climat alors que dans certains contextes politiques, les discours portés par des partis conservateurs qui entretiennent un rapport distant à la science, mettent en avant du climato-scepticisme. Les phénomènes climatiques et environnementaux ne peuvent donc être considérés indépendamment des processus économiques, politiques ou encore psycho-sociaux à l’œuvre.
Faire face aux enjeux du changement climatique implique de pouvoir se représenter les risques encourus, agir malgré l’incertitude et plus fondamentalement, de pouvoir renouveler nos manières de penser le futur de nos professions, de nos villes, de nos territoires. Tout d’abord, la gestion des risques climatiques suppose de disposer de connaissances territorialisées tout en composant avec l’incertitude pour tracer des trajectoires d’adaptation et construire des territoires résilients. Pour ce faire, il est important de pouvoir identifier ce qu’est un “risque”, ce qu’est un territoire vulnérable, tout en ajustant au fil des années les trajectoires d’adaptation en fonction des risques encourus. Les processus psychosociaux qui empêchent de prendre la pleine mesure de certains enjeux sont pléthores : comparer la Côte d’Azur à la côte Atlantique pour relativiser des risques en région, refuser de penser la transformation d’une économie touristique de montagne ou encore portuaire, se sentir protégés par des digues… ces biais supposent autant de nouveaux rapports à construire avec nos environnements maritimes, alpins, etc. De fait, afin de fonder des politiques de gestion du risque cohérentes, adaptatives et acceptables, il est nécessaire de comprendre les spécificités locales et les trajectoires socio-historiques des territoires de la région. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, certains risques sont sur-représentés (inondations, feux de forêts, canicules urbaines) tandis que d’autres émergent tardivement (submersion marine, érosion, retrait et gonflement des argiles…). Par ailleurs, certains évènements traumatiques, à l’instar des inondations dans le sud-ouest des Alpes Maritimes survenues en octobre 2015, ou encore de la tempête Alex dans les vallées alpines de l’est des Alpes Maritimes en octobre 2020, en rappellent l’actualité.
Les institutions et acteurs en responsabilité de la gestion des risques doivent mettre en œuvre des politiques d’accompagnement et de prévention adaptées à ces nouveaux enjeux ; en intégrant à la fois l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Malheureusement, les recherches présentées ici montrent qu’il n’en est pas toujours ainsi. La planification territoriale doit être repensée pour intégrer des projets de territoires concertés et faire avec les habitants, discuter des nouveaux usages, consacrer un rapport renouvelé aux ressources et aux solidarités territoriales. Aussi, aux côtés des décideurs, les citoyens et associations ont un grand rôle à jouer pour coconstruire des politiques adaptées et transformatives, participer à l’élaboration de règles dédiées, élaborer des plans de gestion ambitieux, mais également porter des procès climatiques, ou responsabiliser les grandes entreprises fortement émettrices de GES. Les contestations, bien que peu évoquées dans ce cahier, sont des espaces importants pour porter, à d’autres échelles, les enjeux territoriaux qui se font jour (controverses associées aux méga bassines, déploiement des énergies renouvelables, etc.).
Enfin, de nouvelles interfaces science-société apparaissent et les dispositifs de recherche action participative se multiplient. Il est non seulement possible de faire de la recherche autrement, de corréler les interrogations scientifiques aux demandes formulées par les territoires, mais également d’impliquer des publics plus larges pour construire des savoirs utiles à la décision publique.
| Origine | Accord explicite pour ce dépôt |
|---|